Musée dauphinois
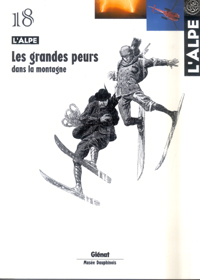
- Nombre de pages : Revue trimestrielle, 112 pages, 23 x 30 cm
-
- Code produit : 1223
- ISBN : 2-7234-3989-5
- € Prix : 14,99
-
- Institution : Musée dauphinois
- Thème : Patrimoine
En même temps qu'ils découvraient dans la montagne le vert paradis où l'homme vivait en harmonie avec la nature, les hommes du siècle des Lumières firent aussi l'expérience de "l'horrible chaos" de ses cimes inhospitalières. Les peurs que suscitaient alors les sommets nourrirent d'innombrables récits. Prenant le relais des anciens établissements hospitaliers que des religieux avaient installés depuis le Moyen Âge, de nouveaux refuges vinrent apporter aux voyageurs la protection contre les dangers. Cette grande peur était toutefois d'abord celle d'hommes qui ignoraient les menaces inhérentes à la vie en montagne et découvraient un monde étranger et différent. Car les populations de montagne, quant à elles, avaient su s'adapter depuis bien longtemps à ce milieu difficile et trouver des parades contre ses menaces. Les recherches sur l'architecture de montagne ont ainsi montré comment les risques avaient été intégrés dans les choix d'implantation de l'habitat, les techniques de construction ou les réseaux de circulation. La constitution du lac de Luc, dans la Drôme, suscita en fait moins de peur parmi les habitants qu'elle ne constitua une menace pour la survie d'une économie rurale privée de ses terrains de culture.
Plus généralement, les enquêtes historiques ont remis en cause l'attitude de fatalité attribuée aux sociétés anciennes face aux risques. Très tôt, les communautés se sont préoccupées au contraire des dangers réels que représentaient crues torrentielles, avalanches ou éboulements, en ont analysé les causes et ont cherché des parades pour protéger les biens et les hommes. Il convient ainsi de relativiser la vision urbaine et technicienne de populations anciennes soumises aux menaces de la nature. À plus forte raison lorsqu'il s'agit de sociétés de montagnes réputées reculées et arriérées. Alors que les changements économiques ont généré de profonds renouvellements de ces populations et que les pratiquants de la montagne réclament une sécurité toujours plus grande, s'impose au contraire de manière impérieuse une réappropriation de cette mémoire et de cette culture des risques. C'est à cette condition seulement que la prise en compte désormais fréquente dans les procédures d'expertises, du critère "d'antécédence historique” à côté de celui de "risque majeur", trouvera toute sa pertinence. René Favier.
Sommaire :
- « Ce plat pays qui sera le mien » Géologiquement parlant, l'histoire des Alpes est, en soi, une catastrophe permanente. Depuis le jaillissement jusqu'à l'abrasion, en passant par les éboulements, les glissements de terrain, les tremblements de terre, les avalanches et les inondations, vie et mort de cimes dont la vocation est bel et bien de finir en plaine au bout de quelques milliards d'années. Par Eugenio Turri.
- « Les miraculées de Bergemoletto » Ensevelies sous l'avalanche, trois femmes survécurent pendant plus d'un mois dans les décombres d'une étable. Une histoire invraisemblable qui défraya la chronique au XVIIIe siècle et constitue, aujourd'hui encore, un véritable record de survie. Par Pietro Spirito.
- « La collision des continents » Les Alpes bougent. À la frontière de deux plaques continentales, elles frémissent de temps à autre, produisant des séismes parfois destructeurs. Appareils et spécialistes auscultent ces turbulences, aussi inévitables qu'imprévisibles. Par Michel Campillo et Guy Perrier.
- « Le choc des chromos » La presse n'a pas attendu Paris Match pour proposer à ses lecteurs des images spectaculaires des grands événements qui secouent la planète. Dès la fin du XIXe siècle, les catastrophes alpines ont ainsi fourni aux illustrateurs des thèmes de choix. Sélection... Par Yves Abraham.
- « Zéro de conduite » Gommer les dangers de la montagne, tel est le nouveau credo des aménageurs comme des pratiquants. Le syndrome sécuritaire touche l'alpe et ses loisirs, qui ne sauraient désormais se conjuguer avec le risque ou l'accident. Une dérive lourde de conséquences juridiques, en passe de modifier radicalement tout un pan de la culture alpine. Par Claude Gardien.
- « C'est la faute à de Saussure » La crevasse l'avait englouti et l'histoire aurait pu s'achever là, en cet été 1800, si un préfet, un guide, un journaliste, et un sculpteur ne s'en étaient mêlés. En somme, une étonnante pièce de théâtre où la montagne se conjugue avec la politique et les bons sentiments. Par Danielle Buyssens.
- « Drame au Cervin » Quatre victimes. Tel fut le tribut payé au Cervin pour sa conquête en 1865. Obsédé par l'élégante pyramide, l'Anglais Edward Whymper s'y attaqua plusieurs fois avant de la vaincre. Une victoire et une tragédie qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme. Par Daniel Léon.
- « L'alpe de miséricorde » Tueuse ou clémente ? La montagne se fait tantôt ombre, tantôt lumière au gré du hasard et de nos fantasmes. Face au mythe tenace de l'alpe homicide, se dresse le visage souriant d'une montagne bienveillante. Petite (et exemplaire) démonstration au travers du portrait, rapidement esquissé, d'un guide hors du commun. Par Jean-Olivier Majastre.
- « Au bonheur des voyageurs (en péril) » Des anges gardiens veillent sur les cols des Alpes depuis toujours. Les antiques divinités tutélaires ont cédé la place à une poignée de saints protecteurs tandis qu'hospices et refuges accueillaient les voyageurs. Face aux périls des traversées alpines, une tradition d'hospitalité s'est ainsi perpétuée au fil des siècles. Par Jean-Loup Fontana.
- « Le Claps de Luc » Un monstrueux éboulement survenu au XVe siècle a modifié à tout jamais une petite région de la Drôme. Témoin de ce désastre qui engloutit villages et champs sous les eaux, le pittoresque paysage du Claps de Luc est désormais un lieu fort apprécié des artistes et des touristes. Vie et mort d'un lac alpin. Par André Pitte.
- « La menace fantôme » Le pergélisol n'est pas l'apanage des terres arctiques. Ce sol gelé en permanence occupe une superficie importante de la haute montagne alpine. Son rôle dans le déclenchement de catastrophes naturelles est désormais bien connu et pourrait, dans le cadre du changement climatique actuel, représenter un péril redoutable. Par Angélique Prick.
- « Chronique d'une mort annoncée » "La tragédie du glacier", titre Paris-Match en cette fin d'été 1965. Sur le chantier d'un barrage, en Suisse, quatre-vingt-huit ouvriers ont péri, écrasés sous des tonnes de glace. Un drame pourtant prévisible. Toujours susceptibles de s'effondrer, les fronts glaciaires sont désormais sous haute surveillance. Par Daniele Cat Berro.
- « La prédiction » Si la journée du 23 octobre 2006 (chacun se souvient que c'était un lundi) est évidemment dans toutes les mémoires, il reste difficile d'expliquer ce qui s'est exactement passé ce jour-là. Non sur le plan des faits, bien entendu ; ni sur celui des dommages, qui sont incommensurables. Mais pour l'interprétation, puisque les rares esprits sensés qui demeurent en sont réduits à la clandestinité. En outre, obtenir des témoignages fiables sur Jean Martinoux est presque impossible : ses adeptes ont substitué, à la vie réelle d'un être humain somme toute normale, une hagiographie emplie de légendes. Une nouvelle de Sylvain Jouty. Et encore…
- « La ville à la montagne » Spécifique, la cité alpine ? Pas si sûr. Si elle doit faire face à des contraintes particulières comme le relief, elle est également de plus en plus confrontée aux mécanismes de l'économie globalisée. Au programme : périurbanisation à outrance et concurrence avec les grandes métropoles de dimension européenne. Le futur, lui, reste à inventer. Avec beaucoup d'imagination. Par Manfred Perlik.
- « La Croisière Jaune » Il y a 70 ans, des artistes, des mécaniciens, des ethnologues, des écrivains et des ingénieurs traversaient l'Asie en automobile. De cette fabuleuse aventure, on pensait tout savoir. On la retrouve pourtant avec gourmandise dans ce beau livre paru aux éditions Glénat. Un récit passionnant et très documenté complété de photographies coloriées pour la plupart inédites. Extrait en Alpes d'ailleurs... Par Ariane Audouin-Dubreuil.
- « De l'or en poudre » Le lait Guigoz a fait le bonheur de générations de bébés. On le doit à un industrieux valaisan. Installé en Gruyère, Maurice Guigoz sut transformer en poudre cette manne alpine et utiliser habilement tous les rouages d'une publicité naissante. Par Maryline Maillard.